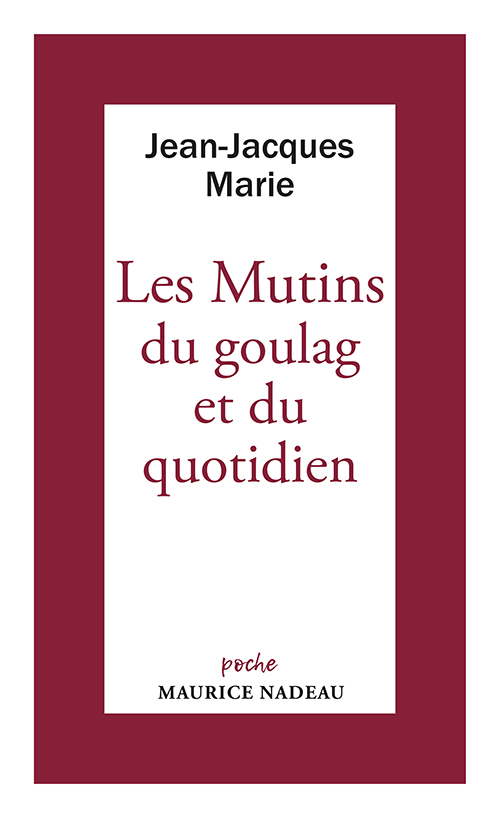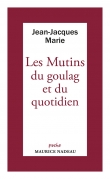Les Mutins du goulag et du quotidien
En librairie le 17 octobre 2025
En URSS, au goulag, « pendant l’année 1945, 51 groupes insurrectionnels ont été découverts et liquidés », affirme un rapport secret à Staline. À la résistance obstinée des détenus du goulag – supprimé en 1960 –, s’ajoute celle des ouvriers qui s’opposent à une législation brutale du travail : « on cessera de faire semblant de travailler quand ils cesseront de faire semblant de nous payer ». Cette grève perlée permanente aboutira à la grève massive des mineurs qui balayera Gorbatchev en 1991. Se basant sur un flot de documents publiés depuis, ce volume tente d’évoquer les principaux événements de cette résistance à la dictature stalinienne.
Jean-Jacques Marie est un historien spécialiste de l’histoire de l’URSS et de la Russie. Il a publié une trentaine d’ouvrages dont notamment des biographies sur Staline, Lénine et Trotsky.
Extrait
Pourquoi ce livre aujourd’hui ?
Au moment même où l’Association Memorial, sanctuaire de la mémoire des crimes staliniens et de la défense des droits humains, est dissoute fin 2021 par la justice russe, sous prétexte de violations administratives liées à son statut d’« agent de l’étranger », sa fermeture révèle la volonté du régime de Poutine de contrôler le récit historique et de réduire au silence les critiques.
Rassembler, publier et analyser aujourd’hui les actes de résistance dans l’URSS permet de mieux comprendre la situation actuelle en Russie. L’histoire soviétique, marquée par une forte répression politique, nous offre une grille de lecture indispensable pour saisir les mécanismes de contrôle et de coercition toujours à l’œuvre dans la Russie contemporaine. Ces récits oubliés ou occultés mettent en lumière une tradition de contestation étouffée, mais persistante, face à des régimes dictatoriaux.
Dans les camps du Goulag comme dans la société soviétique « libre », les actes de résistance ont pris des formes multiples : refus de collaborer, grèves de la faim, circulations clandestines de tracts ou de journaux, critiques du pouvoir dans les milieux intellectuels ou artistiques. Ces gestes, souvent réprimés dans le silence ou la violence, témoignent de la force morale de ceux qui défendaient des valeurs de liberté, de justice ou de dignité humaine face à un système totalitaire.
En les rassemblant aujourd’hui, Jean-Jacques Marie ne se contente pas d’un devoir de mémoire : il éclaire aussi les continuités historiques entre l’URSS et la Russie de Vladimir Poutine. Bien que cette dernière ne soit plus officiellement un régime communiste, elle reproduit certains schémas hérités du passé : concentration du pouvoir, marginalisation de l’opposition, censure des médias indépendants, criminalisation des protestations sociales. La Russie conserve un appareil de répression politique qui s’inspire à la fois des techniques soviétiques et des outils modernes de surveillance au profit d’une oligarchie étatique dont les figures centrales sont, sans surprise, des anciens du KGB.
Ainsi, en redonnant la parole aux résistants d’hier, on met en lumière les failles actuelles de la société russe : absence de pluralisme réel, instrumentalisation de la justice, répression des syndicats et des journalistes. Ces témoignages passés permettent de mieux comprendre les enjeux actuels et de nourrir une réflexion critique sur l’état des libertés fondamentales en Russie.
Gilles Nadeau
extrait :
Après 1928, les autorités cesseront de publier tout chiffre sur les grèves. Elles doivent dissimuler le rejet par les travailleurs des conditions de travail imposées à la population qui s’aggravent à partir de 1929, année de lancement à la hâte d’une industrialisation improvisée et d’une collectivisation agricole brutale, jetant sur le marché du travail des millions de paysans dépouillés de leurs terres.
Le travailleur soviétique est dès lors confronté au système du parti unique hérité de la guerre civile, dans lequel la libre discussion, encore vivante au début des années vingt, disparaît en 1927 après l’expulsion des opposants ; il est aussi confronté au syndicat unique, dirigé par des membres d’une même caste bureaucratique privilégiée et totalitaire.
Le travailleur soviétique ne pouvant secouer cette double contrainte oppressive, tente très vite de la contourner par des ruses de toutes sortes. La plus anonyme est le bulletin nul lors des élections diverses, où se présente la liste unique du « bloc des membres du parti et des sans-parti » ; la plus répandue est la volynka ou « grève à l’italienne », vite devenue rituelle : sans rien dire, l’ouvrier arrive en retard au travail, part en avance, s’absente, se fait déclarer malade, même en bonne santé, et surtout, sans aucune déclaration collective, chaque travailleur présent à son poste de travail s’acharne à travailler le plus lentement possible, à traîner au maximum, voire à ne rien faire tout en feignant de travailler.
La volynka durera en s’aggravant jusqu’à la fin de l’URSS. J’en ai eu une illustration lorsque j’étais lecteur de français à l’Université de Leningrad en 1961. Un jour de février, un de mes étudiants me dit : « mon frère, qui est ouvrier à Stalingrad, arrive demain à Leningrad avec deux ouvriers de son usine qui a lancé un défi à une usine de Leningrad. Il loge dans le même foyer d’étudiant que vous. Je lui ai parlé de vous. Il veut vous voir ». Quelques jours plus tard, rendez-vous est pris. Après quelques questions sur la France, le Stalingradois me dit tout de go : « Savez-vous ce que disent les ouvriers de mon usine ? — Non, comment le saurais-je ? » Il reprend : « Les ouvriers de mon usine à Stalingrad, et pas seulement eux, disent : on cessera de faire semblant de travailler quand ils cesseront de faire semblant de nous payer. »
L’historien russe Afanassiev cite cette phrase, qu’il qualifie de « blague fort répandue à l’époque soviétique » sous une forme voisine : « ils font semblant de nous payer et nous faisons semblant de travailler ».
€ 9.90 € 8.90