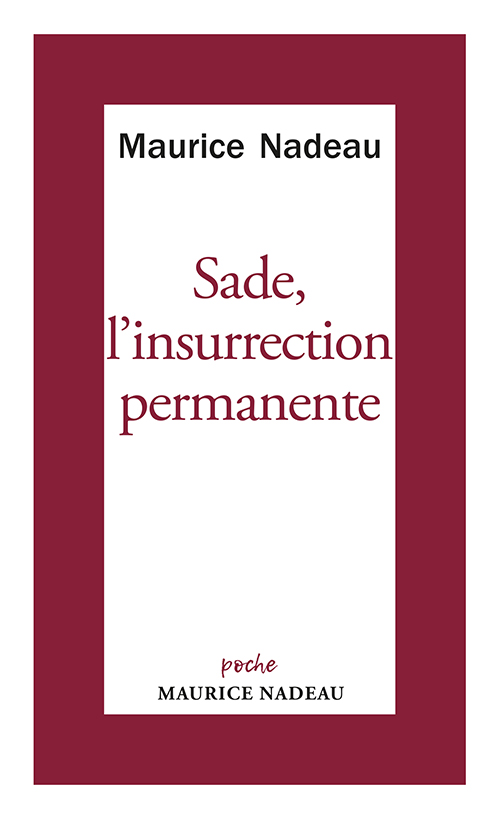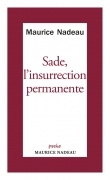Sade, l'insurrection permanente
En librairie le 21 février 2025
Sade, l’insurrection permanente suivi de "Français, encore un effort si vous voulez être républicains" par D.A.F. de Sade et d'une "Biographie de Sade", d'après une chronologie établie par Maurice Heine
Objet de l’opprobre sous la dénomination « sadisme », encore assez répandue dans l’esprit de ceux qui ne l’ont pas lu, l’exposition des turpitudes des puissants et des tyrans ont valu à son auteur l’incarcération de presque toute une vie. Restées plus d’un siècle emprisonnées dans « l’Enfer » de la Bibliothèque Nationale, les convictions philosophiques et « morales » d’un esprit dont l’audace n’a pas de limites, finirent par triompher de sa condition de victime. En 1947, Maurice Nadeau publiait la première anthologie publique des écrits de Sade ; la vente en fut contrariée par la police au nom des bonnes mœurs. Cet ouvrage était précédé d’un essai qui fait l’objet de la présente publication. Plus de 75 ans après, il n’a rien perdu de sa pertinence.
En savoir plus...
Sous le titre "Sade sous l'oeil de Nadeau" Virginie consacre ce 25 février 2025 un article à Sade, l'insurrection permanente dans Litteraemae
Extraits : "Si tout le monde connaît le marquis de Sade (1740-1814), personne ou presque ne l’a lu. Car on dit « connaître » ce dont en réalité on n’a qu’une vague idée, nourrie de préjugés et de fantasmes. Le personnage est sulfureux, son œuvre pornographique et il a inspiré le nom « sadisme ». Voilà pour la « connaissance » commune. (...)
En 2025, alors que notre société se croit très libérée et audacieuse mais végète en réalité dans un conformisme qui de plus en plus souvent tend au repli réactionnaire, il est significatif que la lecture de ce « penseur en prison », selon la belle expression de Maurice Nadeau, soit toujours aussi éprouvante et scandaleuse. Il demeure un caillou pointu dans notre chaussure. L’œuvre du marquis fouille et exhume ce qu’il y a au plus profond de l’être humain, obligeant chacun à s’interroger sur les normes, les lois, la morale, et sa propre nature.
Il ne s’agit pas, évidemment, d’adhérer à tous ses principes (je ne suis pas favorable à la pédophilie ni au meurtre, je vous rassure), mais relire ses textes, en commençant par la stimulante introduction que constitue le brillant essai de Maurice Nadeau, me paraît plus que jamais nécessaire à une bonne hygiène intellectuelle.
****
Dans les colonnes de la Quinzaine littéraire du 15 mars 2002, à l'occasion de la réédition de l'essai de Maurice Nadeau, Sade, l'insurection permanente, Bertrand Leclair s'entretient avec son auteur. En voici la reproduction.
Entretien avec Maurice Nadeau, propos recueillis par Bertrand Leclair (2002)
À chacun son Sade
En 1947, Maurice Nadeau, jeune critique de Combat qui venait de publier une Histoire du surréalisme destinée à faire date, commit une longue préface à une imposante anthologie des Œuvres du marquis de Sade. La censure fut aussi discrète qu'efficace : le livre n'eut seulement pas le temps d'exister. Cinquante-cinq ans plus tard, alors que l'on offre Sade en Pléiade entre deux bûches à Noël, cette étude critique est rééditée. Elle n'a pas pris une ride, tendue par la volonté de rompre avec la légende noire du marquis pornographe pour enfin explorer l'œuvre et la donner à lire comme celle d'un écrivain radical, voire d'un poète. Histoire d'un texte occulté.
La Quinzaine littéraire : La préface rééditée aujourd'hui ouvrait une anthologie de textes de Sade. Comment et pourquoi avez-vous publié cette anthologie en 1947 ?
Maurice Nadeau : C'était la première édition publique de textes de Sade. Le grand spécialiste de Sade à l'époque, Maurice Heine, avait publié la plupart des œuvres de Sade avant-guerre, mais par souscription. Apollinaire avait également publié des Pages choisies, dans sa Bibliothèque des Curieux, réservée aux abonnés. Seule une petite élite intellectuelle avait pu lire Sade, dans des éditions rares, vendues sous le manteau, imprimées soi-disant à Amsterdam pour la plupart, alors que l'on s'y intéressait de plus en plus au sortir de la guerre. En 1947, Pierre Klossowski venait de publier Sade mon prochain, la première étude sérieuse parue en librairie, très subjective dans sa manière de ramener Sade à Dieu, mais qui a eu d'emblée un écho important. Je le voyais régulièrement à l'époque, il m'a d'ailleurs donné son manuscrit, que j'ai récemment retrouvé. Nous en avons discuté des soirées entières. Je connaissais mal Sade en réalité. Je me suis procuré les textes peu à peu, surtout après qu'Armand Hoog, qui était alors critique littéraire de l'hebdomadaire Carrefour (il est mort il y a peu, après avoir fait carrière d'enseignant aux États-Unis), m'a proposé de réaliser cette anthologie pour les éditions de La Jeune Parque, qu'avait fondées Henri Muller à la Libération. Cela m'a demandé deux ans de travail. Rassembler les textes, les lire, essayer de comprendre… Je suis également allé sur les lieux, voir le château de Lacoste par exemple, où je me souviens avoir interrogé les clients du bistrot d'en face. Le château était en ruines, mais les villageois avaient conservé la mémoire de ce drôle de type qui faisait des orgies.
Il faut dire encore que je traversais une période très particulière. J'étais jeune, j'avais 35 ans, il y avait eu l'Occupation, la Résistance, puisque j'appartenais toujours au mouvement trotskyste ; j'avais vu des camarades arrêtés autour de moi, j'y avais moi-même échappé de peu, et j'en voyais certains revenir des camps. D'autres y étaient morts. Il y avait à la fois de la révolte et ce sentiment, dont il est difficile de se souvenir aujourd'hui, qu'avec la guerre tous les espoirs s'étaient effondrés. Dans ce climat, en même temps que le Surréalisme, Sade venait sans doute me conforter dans la quête d'autre chose, jusque dans sa radicalité. J'ai admiré, au-delà de tout son côté excessif - ce côté excessif qui pouvait me faire sourire, mais jusqu'à un certain point, ce point où quelque chose surgit qui révèle en vous-même ce que l'on n'a pas envie d'y voir, et qui en même temps vous fascine.
Q.L. : N'est-il pas dommage de n'avoir pas réédité l'ensemble, y compris le choix de textes que vous aviez composé ?
M. N. : Le volume comptait plus de cinq cents pages, extraites de la plupart des ouvrages de Sade. C'est pourquoi je n'ai pas pu le réimprimer en totalité, le coût aurait été trop important, d'autant que ces textes sont presque tous, aujourd'hui, en éditions de poche. J'avais fait un choix, qui me convenait il faut bien le dire, mais qui me paraissait aussi très significatif, que j'avais découpé en grandes catégories, la morale, la dialectique, la philosophie, catégories que l'on retrouve en tête de chapitres de la préface. J'avais essayé de trouver un fil, de montrer l'évolution de la pensée de Sade.
Q.L. : Cela devait avoir une dimension réellement angoissante, une plongée aussi solitaire dans cette littérature interdite, dans l'Enfer de la BN ?
M.N. : D'autant qu'à l'époque ce n'était pas considéré comme de la littérature. Il y a eu un virage quelques années plus tard quand Blanchot a fait paraître son Lautréamont et Sade. Personnellement, la curiosité m'avait saisi bien plus tôt, en écoutant Breton et les autres avant-guerre. J'avais d'ailleurs rencontré Maurice Heine en 1939, au cours de réunions avec les surréalistes. C'était un homme distingué, très élégant, avec une grande cape noire, ami de Breton, aimanté par le courant surréaliste sans en faire partie. Après guerre, j'ai pu consulter à la Bibliothèque Nationale, dans ce qui s'appelait à l'époque l'Enfer et où je suis effectivement allé copier les textes que je n'avais pu trouver ailleurs, la biographie à laquelle Heine avait travaillé ; elle n'était pas rédigée mais déjà ordonnée chapitre par chapitre, et tous ceux qui sont venus ensuite l'ont utilisée.
Connaître la vie de Sade aidait à séparer l'homme et l'œuvre : le scandale qu'avait été sa vie, ce côté grand seigneur, apparenté à une des plus grandes familles de France, de ce qu'il avait écrit. Ce n'est pas si simple. Même ce qu'il a écrit n'est pas simple, d'ailleurs ; c'est un lieu de contradictions. Avant qu'on le tienne pour un écrivain, il a fallu que tout le monde s'y mette, de Bataille à Blanchot, pour dire qu'il ne s'agit pas de pornographie, qu'il y a une pensée, une morale, une philosophie. Ensuite, beaucoup plus tard, les universitaires sont venus, comme Michel Delon, qui ont rendu justice à Sade écrivain et philosophe.
Q.L. : Comment se fait-il que votre volume n'ait fait l'objet d'aucune condamnation ?
M.N. : En France du moins, puisqu'il a par exemple été interdit en Suisse. C'est qu'il s'agissait d'un choix, non des œuvres intégrales comme Jean-Jacques Pauvert a entrepris de les publier beaucoup plus tard, non sans démêlés judiciaires. Surtout, l'éditeur avait pignon sur rue ; Armand Hoog était un critique respecté, qui écrivait dans un journal plutôt de droite. Il y avait donc toutes les garanties de moralité. Mais lorsque le livre a paru, il est resté introuvable en librairies et personne n'en a parlé dans la presse.
Q.L. Par auto-censure, par souci de respectabilité ?
M.N. Je ne sais pas. Peut-être cela n'intéressait-il pas les critiques. Il faut se souvenir de ce qu'étaient les journaux de l'époque, aussi. Quant aux libraires, ils risquaient d'être poursuivis. Enfin, j'avais, moi, mauvaise réputation : c'était l'époque du procès de Henry Miller pour "atteinte aux bonnes mœurs". Des libraires avaient été poursuivis, puisqu'à l'époque la loi ne faisait pas de détails, et les mesures de police étaient constantes, pas toujours signalées. Par exemple, je me souviens d'avoir préparé une édition de Sexus qui a été retardée après que la police était allée chez l'imprimeur pour répandre sur le sol toutes les casses, toute la composition aux plombs. Tout était à refaire, alors évidemment, on abandonnait sans qu'il se soit rien passé d'officiel ; personne n'en savait rien. Cela dit, mon livre a tout de même été publié. Quelques personnes l'ont lu. Dans l'édition de La Pléiade, Delon a signalé la parution de cette première anthologie publique en précisant qu'elle avait "fait date", preuve qu'elle avait trouvé ses lecteurs où ils étaient.
Q.L. : Quel effet cela fait-il, cinquante ans plus tard, de savoir que Sade est désormais disponible en Pléiade ?
M.N. : À partir du moment où on l'envisage comme écrivain, même scandaleux, on admire une pensée d'une lucidité radicale avant de le voir comme un visionnaire, un poète ("tout le bonheur de l'homme est dans son imagination"). Pour Annie Lebrun, un poète surréaliste. Voilà, c'est disponible, en livre de poche, ça fait partie de la bibliothèque, au rayon des romans un peu excessifs, pas loin des romans noirs… Il y a un côté d'ailleurs roman gothique, avec par exemple le château des Cent vingt journées, cette forteresse qui semble reconstruire la prison de Vincennes où il a passé, il ne faut pas l'oublier, plus de vingt années de sa vie.
Q.L. : À défaut du choix original, vous faites suivre votre étude d'un texte de Sade, Français encore un effort si vous voulez être républicains. Faut-il y voir une volonté qui demeure de tirer Sade vers le politique ?
M.N. : C'est un clin d'œil, à quelques semaines des élections, mais cela correspond également au désir de montrer l'anarchiste qu'il était aussi. Sade est un utopiste, parfois délirant, mais qui apporte un sentiment de libération, comme tous ceux qui ont rêvé un état social moins désastreux que le nôtre. Relisant la fin de mon essai, j'ai pu trouver osé, d'avoir raccordé Sade à Marx, mais c'était cette perspective aussi, tendue vers l'utopie d'une société où l'homme pourrait vivre une vie pleine et entière et atteindre le bonheur, qui me fascinait.
Q.L. : Il doit y avoir une très grande satisfaction à rééditer tel quel ce livre, alors que de gigantesques sommes d'érudition ont paru depuis sa première publication, et à constater qu'il n'a pourtant rien perdu de son actualité, de sa pertinence.
B.L. : Cela vient aussi du fait que, comme c'est le cas avec tous les grands écrivains, chacun peut tirer Sade à soi. À chacun son Sade. Cela dit, il y a une satisfaction, quelque peu inavouable, à avoir été l'un des premiers à écrire ouvertement sur lui, et à le rappeler en rééditant ce texte que peu de gens connaissaient.
€ 10.90 € 8.90