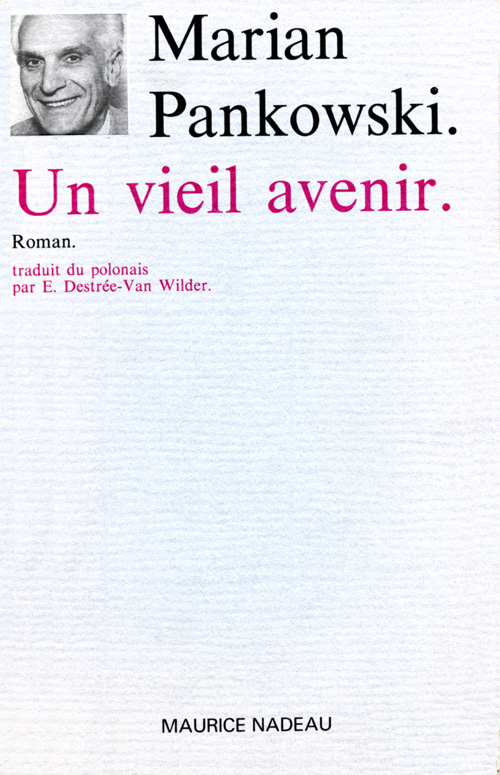Un vieil avenir
Roman d’anticipation, Un vieil avenir se déroule dans un royaume débonnaire qui pourrait ressembler à celui où s’est réfugié l’auteur. Son héros, immigré d’origine slave, refuse de se laisser assimiler. Interventions officielles, flatteries, pressions diverses, rien n'y fait. Voilà la machine grippée, la concorde nationale mise à mal. S'il s'acquitte du "quart d'heure de violence quotidienne" obligatoire, il dévoie par ses récits sensuels une jeune sociologue, il joue le trouble-fête au réveillon de la Maison du Retraité Méritant, il compromet la célébration d'une Saint-Sylvestre exceptionnelle en présence des "chers Souverains". L'ironie, le sacarsme, la satire, drôle ou féroce, caractérisent cet ouvrage d'un virtuose de l'écriture. Traduit du polonais par E. Destrée-Van Wilder. 168 p. 13 euros (1989)
Marian Pankowski, né le 9 novembre 1919 à Sanok et décédé le 3 avril 2011 à Bruxelles est un philologue, écrivain, poète, critique et traducteur polonais. Il a prit part aux combats de l’armée polonaise. Arrêté en 1942 pour faits de résistance, il fut envoyé à Auschwitz. Transféré dans différents camps, la Libération le trouva à Bergen-Belsen, d’où il rejoindra Bruxelles. Il se fixa dans la capitale belge, où il poursuivit ses études. Devenu professeur, il a enseigné la littérature et la langue polonaises à l’ULB. Il est l’auteur de nombreux romans (traduits et publiés aux éditions Actes Sud, l’Age d’homme) ainsi que de pièces de théâtre : 'Les pélerins d'Utérie', 'Le gars de Lvov', 'Le thé au citron', 'Le retour des chauves-souris blanches' et 'L'or funèbre' en 1993. (Actes-Sud)
Extrait
Trois nuages cousus de robes nuptiales élimées jusqu’à leur trame, faite d’une structure inoxydable, glissent lentement dans le ciel. Signe que l’aube est tout tout près, puisque l’Institut Royal Météorologique les a lâchés au-dessus de la capitale. Ils se rapprochent, encore, encore. Les voilà sur le Palais. Zeppelinesques, mais avec des rondeurs corrigées au compas d’un Rubens.
Pour les jeunes, ils sont l’évidence même. Les vieux, eux, les saluent d’un sourire qui en dit long. L’avant- dernier royaume du continent n’a pas les moyens, tout simplement, de fréter une plus grande abondance de paysage mobile pour rendre cette voûte semblable aux cieux d’autrefois, ces cieux que nous ne connaissons plus que par la littérature et les bandes dessinées, ces cieux où, à cette heure, les coutelas s’en donnaient, égorgeant des troupeaux d’agnelets et de colombes.
En ces temps-là, les vents aussi pouvaient voyager sans souci. En ces temps-là, les pluies d’or, les pluies zeusiennes pouvaient pénétrer tous les creux des contrées. Aujourd’hui, l’eau céleste nous est rationnée. Pour éviter la désertification de la terre.
Les superpuissances, c’est comme ça. A l’aide de gigantesques télescopes, elles allèchent les précipitations, ce qui cause des sécheresses de longue durée dans les pays pauvres - lesquels, il est vrai, peuvent toujours recourir aux processions implorantes et aux conjurations des spécialistes.
Sous la surface de notre terre, il n’en va pas autrement. Les puissants voisins pillent les nappes de pétrole, se servent d’énormes « sangsues » qui franchissent des centaines de kilomètres à la manière des taupes afin de s’attaquer aux nappes et de traire la brune matière première.
Une fois révolu l’âge de la splendeur industrielle, notre Royaume s’est habilement tourné vers l’exploitation des richesses muséales. Les visites de nos châteaux sont en vogue dans le monde entier. L’été, quand il ne pleut pas. Dès la gare ou l’aéroport, on revêt les touristes d’habits du Moyen Age. Ensuite, ils se promènent par les rues, entrent dans une auberge pour un repas, ou deviennent même, malgré eux, les témoins d’une querelle Renaissance allant jusqu’à des invectives choisies par des historiens de la littérature. Finalement, on les amène devant les tableaux de nos peintres. Ils restent là plantés, bouche bée. A se regarder, à regarder le tableau. Ils sont tout émus, comme si on les avait vidés de leur contemporanéité, leurs deux identités se sont mélangées, celle d’aujourd’hui, d’emprunt, et celle-là, celle du patricien ou celle du chevalier. Bien sûr, il leur faut ensuite quitter ces velours, ces brocarts...
Mais les villes ne sont plus les mêmes. Ne serait-ce que par l’absence de chiens. Pas le moindre chien. On les a exterminés, parce que l’Institut Royal d’Hygiène a découvert qu’ils étaient colporteurs de cette épidémie fécale qui, au cours de la dernière décade, a exterminé plus de soixante mille citoyens européens, des enfants surtout.
Les symptômes étaient affreux. Des taches rouges autour du nez accompagnées d’une kératose des yeux et d’une paralysie des voies biliaires.
Les procès intentés aux Autorités par la « Société de Défense du plus fidèle Ami de l’Homme » n’y firent rien. Un petit film documentaire tourné en période d’épidémie constituait l’argument décisif. Aux citoyens frustrés, on recommandait l’adoption d’orphelins ou de vieillards.
Ici aussi par conséquent, dans cette Maison du Retraité Méritant, on essayait d’adopter des copains de la chambre voisine. Accueilli comme un enfant unique, le septuagénaire se comportait d’abord gentiment, s’efforçant de plaire à son protecteur, récitant des comptines. Cependant, une semaine plus tard, pris par son rôle, il devenait insupportable. Bien sûr, cette attitude était une nouveauté dans la vie émotionnelle de la chambre, mais transformée, au bout d’une semaine, en habitude, elle suscitait des éclats de colère de plus en plus fréquents chez le tout nouveau père adoptif.
L’administration de la Maison fut forcée de renoncer à cette expérience le jour où un petit vieux junior qu’on avait privé de dessert pour le punir rossa son bienfaiteur et le jeta hors de la chambre.
Du côté des dames, les filles adoptées se comportaient de façon beaucoup plus sympathique. Leurs tendances innées à la minauderie facilitaient les relations. Ce fut bien autre chose qui suscita le scandale et l’interdiction de tenir des animaux.
Un beau matin, à la porte de la chambre 69 où logeait Françoise, ex-directrice du Centre de Reproduction du Cheval européen sonnèrent trois inspecteurs du Service de la Santé Morale.
Tout le quatrième étage retenait son souffle. On échangea une multitude de regards-sourires en coin. Un bon quart d’heure plus tard, ces messieurs sortirent, tenant par la bride un cheval lilliput. Il ruait, ses dents lançaient des éclairs, il tentait d’effrayer les fonctionnaires, et finalement, il éclata en sanglots. De manière chevaline. Françoise se tenait dans l’embrasure de la porte, pointant sur les exécuteurs son menton dur et fort moussu.
Tout cela se passait entre gens civilisés, cultivés, quoique sans aucune allusion aux villes de la Bible. On se contenta donc de mettre en exergue le rôle de l’hygiène dans la lutte contre ces maladies toujours nouvelles qui s’attaquent impudiquement aux hommes comme aux femmes. Peu de gens eurent l’idée d’analyser plus en profondeur l’importance de l’adverbe cité ci-dessus.
Rien d’étonnant donc si un vide émotionnel bien compréhensible régnait sur la Maison du Retraité Méritant.
Pour autant que la mémoire ne nous trompe pas, le bâtiment avait été construit dans les dernières années du deuxième millénaire, en 1995, peut-être même un an plus tôt; on l’avait doté d’installations dont les hôtels voisins n’auraient pas eu à rougir.
Certaines conceptions sont tellement d’avant-garde qu’elles en sont controversées. Il en va ainsi d’une répartition selon les étages conçue de telle sorte que chacun d’eux constitue presque une société en soi, une société assortie en vertu de critères qui sautent aux yeux.
Le rez-de-chaussée est occupé par les seniors que distingue une obésité excessive. Tenons-nous ici, au bout de cet imposant corridor et cachons-nous le visage d’un bouquet. Le mieux, c’est de prendre des freesias mauves, vaporisés de gypsophile en abondance, car alors, en faisant mine de respirer tout ce duveteux en fleurs, nous pouvons observer le corridor d’un œil de limier débutant.
Ce qui s’impose au regard, c’est l’exiguïté de mouvement des habitants de ce rez-de-chaussée. Des figurants en quelque sorte. Ils apparaissent dans les embrasures de portes, ils sont juste un élément de l’architecture. Celui-là, là-bas... il signe un récépissé de lettre recommandée. Cet autre, là, il présente sa vaisselle du dîner d’hier. Ils tournent lentement, comme si le monde entier les intéressait, un monde converti pour eux en bordure de carrousel. Ils jettent encore un coup d’œil en arrière, méfiants, comme s’ils craignaient qu’on se moque d’eux.
Etage par étage, la corpulence des seniors et senioras diminue, si bien que le quatrième abrite une population toute légère. De maigrichonnes petites vieilles. Mais elles se meuvent avec grâce, presque avec vivacité. Les petits vieux sont alertes. Presque tous arborent moustache bien soignée. Ce n’est pas comme au rez-de-chaussée : les taciturnes manquent, ici. Gesticulations, éclats de rire forment la toile de fond de presque toutes les conversations.
Les hommes sont en minorité. La longévité croissante des femmes a conduit à une surpopulation en élément féminin de la Maison du Retraité Méritant, comme de toute institution de ce genre du reste. C’est ici qu’on le voit le mieux, ici, au quatrième étage, un étage baptisé « Golfe ensoleillé ». Quand on regarde le fond de ce corridor large comme un patio, de cet endroit où pourrait se tenir le monsieur aux freesias (s’il s’était donné cette peine), nous avons à main droite les chambres des dames. Chacune a été prévue pour une seule pensionnaire. A présent, elles y sont à deux, et même à trois. L’Administration de la Maison a été contrainte d’appliquer le critère du rapport directement proportionnel du corps vivant au mètre cube d’espace. Ça a réussi, et même sans grandes difficultés. Ces dames maigrichonnes circulent dans leur chambre, en évitant les collisions frontales et les — oh combien douloureuses ! — rencontres d’un coude pointant hors du corps.
Du côté des messieurs, de semblables essais ont abouti au fiasco. Le mâle défend farouchement son territoire. Les coups bas n’étaient hélas pas exceptionnels. Il suffisait en effet de dénoncer le comportement non hygiénique du colocataire pour que celui- ci soit transféré, par mesure disciplinaire, dans une de ces baraques qu’on appelle, depuis des années « provisoires » .
Le cinquième étage... Au fond, seuls les habitants du quatrième en savent quelque chose. Et encore, pas tous.
Il arrive que deux d’entre eux, occupés à discuter, emportés par le rythme de la promenade le long du patio, dépassent ces fourrés plantés serrés, l’un contre l’autre, qu’ils écartent ces feuilles de cuir épais et parviennent au bout du corridor. Et là, c’est la surprise. Le corridor tourne et se mue en escalier. Un escalier muré. De la brique ordinaire, de dessous laquelle, çà et là, saille un ciment qu’on a claqué généreusement.
Et nos bavards s’en reviennent au plus vite, pour regagner le patio, le brouhaha, ce corso de villégiature qui défile, dans un sens, dans l’autre. Mais ce mur s’est enfoncé dans les pensées des vieux et il y reste comme une ruine qu’arpentent des chats pelés, des mésanges criantes plein la gueule.
— Mais pourquoi donc ce mur ? demande l’un ou l’autre pensionnaire, comme ça, en passant.
— Problèmes de chauffage, répond un des employés de la garde. En hiver, c’est une vraie glacière. C’était bien à regret, mais la coopérative à laquelle notre Maison appartient a dû renoncer à nous attribuer ces locaux.
— Et ces... ces hélicoptères qui atterrissent sur le toit... deux, trois fois par semaine ?
— Justement... ce sont des contrôleurs des installations de chauffage. Sans leurs bons soins continuels... vous ne disposeriez pas... non... de cette douillette atmosphère qui règne au quatrième...
La maison du Retraité Méritant s’élève donc telle une pyramide de vieux et de vieilles qui vont s’amenuisant vers le ciel. Dommage seulement que le sommet de cette pyramide soit comblé — si l’on peut dire — par le vide, un vide plein de sous-entendus, un vide qui attire, comme les superstitions.
Aujourd’hui, plus de vingt ans après la fondation de l’institution, la surpopulation est devenue la norme. Ne parlons même pas de l’existence des pensionnaires qui s’est bien éloignée des préceptes rigoureux édictés par le Ministère de la Santé. On a commencé par des changements dans la conception de l’habitat. Bien sûr, les fenêtres constituent toujours une importante surface de contact avec le cosmos : le bronzage de ces peaux relâchées... et puis... cette métaphysique, hein, tout de même... Néanmoins, les fenêtres ont perdu de leur importance avec le temps, au profit de ce corridor si large et si hospitalier qu’il rappelle la cour intérieure des auberges espagnoles tant il y a ici de bancs séparés par des palmiers d’éternel plastique vert, de bancs propices à la causette, d’où l’on peut voir-épier les promeneurs.
Oh ! maintenant ! Au milieu de ce patio, deux petites vieilles vont et viennent. Des élégantes. Cette année, la mode est de nouveau « villageoise », ou « tsigane ». Ça revient au même, car ces robes conservées depuis le temps de l’opulence charnelle se portent maintenant avec « une opulence de plis ».
Les voilà arrivées à ces arbustes aux grosses feuilles luisantes. Elles ont tourné de façon si gracieuse que les satins et les soies rétro ont ondoyé, suggérant une théâtralité grécomarmoréenne. Si toutes les habitantes du quatrième se prenaient maintenant par la main et s’élançaient en dansant dans notre direction, on pourrait dire : des choristes d’Eschyle ou quelque chose du genre...
Là, presque sous les palmiers, Sophie tient par le bras la blême petite veuve d’un banquier Krugerandi qui jadis fut célèbre. Formellement, c’est-à-dire morphologiquement, Sophie pourrait être représentée comme une petite armoire, comme une bonnetière avec miroir, car elle est de ces femmes « sans taille », bâtie selon la mode qui régnait à l’époque des influences de la sculpture esquimaude.
Et le miroir ? Le miroir, c’est pour faire symbolique, et aussi pour suggérer une vivacité de réaction aux aiguillons du monde environnant.
Elle regarde maintenant dans les yeux sa compagne pâlotte et d’un mouvement de tête, elle exprime sa désapprobation. Elle s’est arrêtée :
— La « médecine »... la « chimie »... tu répètes ces mots avec onction et avec crainte, au lieu de faire confiance à la nature. Si ce lourdaud du 49 s’était soumis au traitement que je lui avais prescrit... nous pourrions le voir en ce moment, là tiens, assis à la petite table, le porte-cigares d’argent entre les dents... Le porte-cigares, il est bien là, oui, et personne n’ose aller l’enlever...
— Tout de même, un homme qui a eu son bachot ne pouvait croire au... au pouvoir miraculeux d’une pomme !
— Bêta... Une pomme, une pomme simplement cueillie de l’arbre, c’est bon pour allécher le mec, comme au paradis, ou bien comme purgatif... Il faut une pomme spéciale. Ce doit être une pomme d’août. Tu as sûrement entendu dire que ce sont les plus précoces des pommiers. Ils proviennent des pays des bords de la Baltique, rapport à l’ambre, tu comprends... Ils portent des fruits jaunâtres, savoureux. Mais ce n’est pas tout. Il faut encore des clous.
— Des clous ? Où irai-je prendre des clous ?
— Il suffit de longer, au petit matin, l’un ou l’autre chantier... mais si tu n’en trouves pas, je t’arrangerai ça.
_ ?
— Tu y enfonces ces clous, autant qu’il y en a. Que la pomme soit comme un hérisson. Tu la mets à la fenêtre, au soleil. Que la douleur s’installe bien dans ces blessures, que ces plaies se mettent à suppurer roux. Laisse cette rouille rouiller à son aise... Après une semaine, cet oxyde de fer en bouillonne, il brûle d’aller échauder cette maladie. Alors, retire les clous, délicatement... La pomme, elle, c’est pour toi. Et... bon appétit !
— Brr...
— « Brr » ? Comme tu veux. Ce lourdaud, là, du 49, il a aussi fait « brr »... C’est tout le cas qu’il faisait de mon conseil. Et c’est bien pourquoi, là, sur la petite table, il ne reste plus que ce porte-cigares...
Et avec énergie, elle ramène la veuve transparente du banquier Krugerandi. Elles reviennent par le centre du patio, elles en sont presque niçoises, estivales, cillant des yeux éblouis par la mer, par cette Méditerranée du temps de leur deuxième dentition...
De dessous leurs blancs sourcils froncés, les gentlemen nonchalamment assis sur les bancs les observent. Celui-ci s’est laissé glisser les lunettes sur le bout du nez, comme il sied à un intellectuel; celui-là fait tourner de la main la canne qu’il tient entre les jambes, et le pommeau d’ivoire luit ! Et les bobonnes en ont plein la vue ! Hé là ! Doucement ! Pour un peu, ça giclerait !
Mais le temps fait son œuvre, et pas seulement dans le domaine des règlements de l’institution. Ce même temps endommage aussi les installations. Aussi voit-on se multiplier toutes les fuites possibles, les fissures s’élargissent. Par suite de quoi crèvent les crépis, bombent les plafonds. Et les baignoires, complètement bouchées, débordent, une semaine durant parfois, d’eaux fermentantes.
Sans doute nos plombiers équipés de sondes à laser rendent-ils aux conduits leurs allures d’égouts. Mais on a peine à suivre le train, tant il y a d’avaries... Aux rapports de réparations on joint le plus souvent une pelote de cheveux gris, amassés en plique autour d’une prothèse stomatologique.
Cette non-étanchéité s’étend de toute évidence aux habitants. Telle est l’origine de cet air saturé d’une odeur de patates gelées, de cet air douceâtre, de cette odeur de langes. Eh quoi... le patio espagnol d’une maison pauvre, vers la fin mai.
— Fermez la fenêtre, s’il vous plaît, dis-je à la Secrétaire. Et baissez le store.
Sans sourire, elle exécute ces deux gestes et, d’une cascade d’agréable pénombre, me sépare du jardin, de ce jardin où l’étourneau gris a commencé à siffloter, comme sur une flûte fêlée, tout en faisant le tour de la souche vermoulue du mélèze.
Déjà, tout s’est tu. Il sait que ce nouveau silence qui est le mien n’a pas pour but de l’exclure ni de l’humilier, car il se rappelle comment l’automne dernier — et même l’avant -dernier automne peut-être — il me tomba ici du ciel, entraînant derrière lui un filet de fumée de cette explosion qui avait réduit en bouillie puante soixante mille de ses frères gloutons. Il se rappelle bien que je lui apportai un bol d’eau fraternel. Depuis ce temps-là, un regard dépourvu de crainte nous unit tous les deux.
J’ai eu cette secrétaire par les petites annonces. Dans les années quatre-vingt-dix du siècle passé, on les recrutait parmi les orphelines. Ces jeunes filles suant le chagrin convenaient on ne peut mieux à la transcription des poèmes, des paroles de rengaines surtout. Celles qui avaient leur bac parvenaient même à consigner assez bien les effusions de ces catastrophistes qui apparaissent régulièrement, comme des vesses-de-loup de la pensée magique, vers la tombée des siècles.
Eh oui, mais l’an 2000 a passé sans les secousses attendues. La littérature et les beaux-arts se sont remis à fleurer le magnolia, le bas-ventre et la bohème. A Cannes, on a vu de nouveau des starlettes de douze ans plonger — d’après ce que j’ai lu — dans une fontaine qui lançait, à l’occasion de l’immortel Festival, une eau mousseuse au goût de champagne de réveillon.
Après les secrétaires orphelines est venu le tour des filles de familles séparées. Ce n’est pas sans raison que les romanciers réclament des créatures déprimées. Il est de plus en plus difficile d’en obtenir, empressons- nous de le dire, car une législation indulgente en matière de divorce et d’interruption de grossesse a provoqué un véritable dépérissement de ces émotions qui, depuis des siècles, accompagnent la séparation des parents ou la suppression du fœtus.
La mienne, de secrétaire, elle se caractérise par sa façon simple d’aborder tous les problèmes.
— Avec du sucre ?
— Avec du sucre.
Elle arrive ponctuellement à neuf heures. S’assied dans le vieux fauteuil de bois, se cale bien au fond, jusqu’à sentir le dossier, et puis écrit, sous ma dictée, jusqu’à midi, mon nouveau récit. De temps en temps, régulièrement, elle s’essuie le visage, d’un mouchoir de papier qu’elle jette dans la corbeille où je jette mes brouillons.
A propos d’écriture. Ce que nous avons raconté jusqu’à présent est à peine une description de la scène. Le lecteur a pu discerner une certaine réalité parvenue à un stade de décomposition harmonieuse. Peut-être a-t-il aussi ressenti çà et là des associations verbales qui désiraient passer pour de la littérature. Néanmoins, sans doute la chose lui est-elle apparue comme une partie d’un monde objectif qui, ayant atteint sa majorité, feint de durer dans sa forme première, luxuriante.
Dans une telle situation, l’ingérence de l’écrivain devient nécessaire.
A ce comportement provocant d’une rivière qui feint de ne pas couler, de scintiller seulement, il réagit par un cri. Il en cingle cette eau empotée si bien qu’elle se cabre, effrayée par cette violence, et se précipite, emportant les vivants et les morts, de plus en plus vite...
Elle a bâillé. Elle a souri à quelque chose, qui lui était passé en tête. Sans doute à cette souche vermoulue, enveloppée de ce manège d’un oiseau invisible et désoiselé de sa jeunesse, de sa sauvagerie. Elle attend que je commence. Je sais qu’il est temps d’ouvrir la bouche. Voilà.
« Vingt ans ont passé depuis ce décembre-là. Je suis installé aujourd’hui à la Bibliothèque Royale, derrière la table de chêne recouverte d’annuaires de journaux, et je prends des notes, interrogeant de temps à autre, dans des conques d’écouteurs, des enregistrements de reporters... »
La Secrétaire me regarde à la dérobée : c’est la dernière, ça ! Que vient donc faire cette Bibliothèque Royale dès lors que je suis occupé à raconter ici, dans mon bureau de trois mètres sur quatre mètres trente, d’où l’on n’a pas vue sur l’Hôtel de Ville, mais sur ce jardin déjà mentionné qui s’en tient loyalement aux almanachs inspirateurs de noms de fleurs et des proverbes ?...
Mais venons-en au fait !
Lentement, des témoignages, des articles émerge une ébauche, la silhouette d’un type, simple pensionnaire aujourd’hui, qui demain va se buter, se barricader. Un tueur qui étripa la plus vénérable des cartes géographiques du Royaume.
€ 16.00