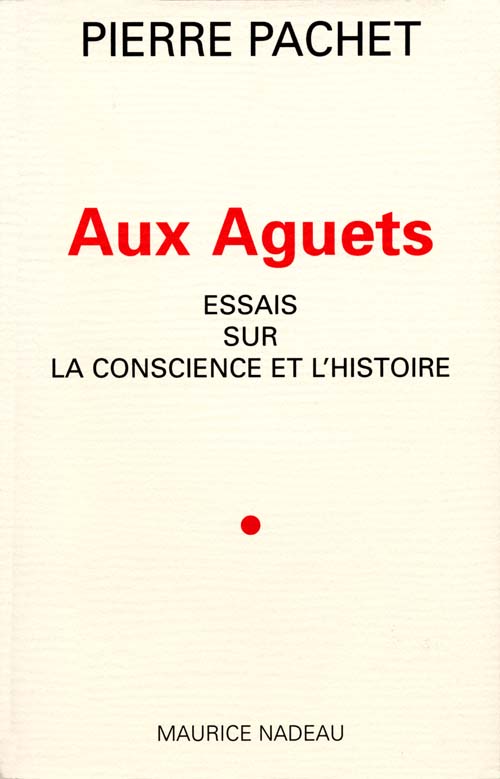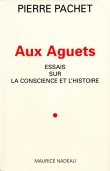Aux aguets. Essai sur la conscience et l'Histoire
Essais sur la conscience et l'histoire. Ce volume rassemble des textes composés par l'auteur au cours des vingt dernières années. Ils témoignent du lien singulier qui s'affirme dans sa réflexion entre une donnée très intime, et la réalité collective et historique. D'un côté, la conception d'une conscience à la vigilance envahissante, une vigilance qui ne cesse pas et se prolonge jusque dans le sommeil (voir les précédents essais de l'auteur, Nuits étroitement surveillées et La force de dormir, parus chez Gallimard) ; de l'autre l'attention portée de façon réitérée, au fil des années, à des situations politiques ou historiques dans lesquelles s'est déchaînée la violence : violence révolutionnaire dont témoignent des oeuvres comme celle d'André Platonov, de Mikhaïl Boulgakov, de Pierre Pascal ; violence totalitaire exercée dans les formes contemporaines de la torture, ou dans la catastrophe engendrée par le nazisme, à laquelle réfléchit Simone Weil.
La méditation de Pachet cherche à comprendre comment son propre souci de vigilance réagit au sentiment d'être encerclé par la violence du monde ; et surtout à faire apparaître la violence à l'oeuvre dans le rapport de la conscience à elle-même, une conscience cruelle, excessive, tant elle est avide de voir et de connaître ; une conscience dont les mouvements - dans la relation avec les animaux, dans la privation volontaire, dans la pensée du meurtre ou de la torture subie ou exercée - finissent par prendre dans ces pages une dimension fantastique et presque romanesque. 193 p. (2002)
Pierre Pachet est né le à Paris et mort le dans la même ville. Pierre Pachet a publié chez Maurice Nadeau Le premier venu, essais sur la politique baudelairienne (1976). Maitre de conférences, il a publié d'autres ouvrages consacrés à la littérature (Les Baromètres de l'âme, Un à Un), au rêve (Nuits étroitement surveillées, La Force de dormir), aux soubresauts de l'Europe de l'Est (Fiodorov et Mourjenko - Camp n°389/36, Le Voyageur d'Occident, Conversations à Jassy (Maurice Nadeau). De formation helléniste, il est l'auteur d'une traduction de La République de Platon chez Gallimard. Son Autobiographie de mon père (Autrement, 1994) a été très remarquée. Depuis 1970 et jusqu'à la crise qui conduit au départ de l'équipe du journal en 2015, il est membre du comité de rédaction de la Quinzaine littéraire, bimensuel au format tabloïd fondé par Maurice Nadeau. Outre des comptes rendus de livres, il y publie une chronique mensuelle intitulée « Loin de Paris », puis « Désoccupé ». Il est ensuite jusqu'à sa mort en 2016, membre de la direction éditoriale d'En attendant Nadeau.
Extrait
Histoire et conscience
En reprenant et en rassemblant certains de mes essais des années 80 et 90, je vise à éclairer, et d’abord pour moi-même, la relation étroite qui s’y affirme entre l’expérience d’une conscience inquiète, pourvue d’une vigilance démesurée, et certaines situations historiques dont le souvenir ou la pensée ne me laissent pas en repos. Aussi le présent ouvrage, en même temps qu’il veut faire un pas de plus dans la connaissance des choses, a-t-il, comme d’autres livres que j’ai publiés auparavant, un caractère au moins indirectement autobiographique.
Il me semble que ce qui a marqué le plus profondément mon rapport à l’Histoire, et que je voudrais dégager pour présenter mes réflexions avec le plus de netteté possible, tient pour une grande part aux années de l’Occupation, de 1940 à 1944. Années d’enfance, de silence, de peur, qui ont sans doute été présentes derrière nombre de mes perceptions et de mes réflexions d’adolescent, puis d’étudiant, de jeune homme, et d’auteur. Au moment de la Libération, à Saint-Étienne, en 1944, qui me donnait l’impression d’ouvrir sur une liberté désordonnée qu’à bien des égards l’enfant que j’étais trouvait effrayante, j’ai appris que mes parents, ma sœur et moi étions juifs, et reçu les premiers éclaircissements sur ce que cela pouvait signifier. J’ai appris surtout que, jusqu’à la veille, si je me taisais, c’était parce que j’étais tenu de me taire, parce qu’un danger menaçait chacun de nous qui était autre que le danger de la guerre (les bombardements du printemps 1944, je les avais entendus, sentis, et de près). Au moment où j’étais invité à vivre normalement, à ouvrir et à épanouir ma conscience, je découvrais la terreur passée. Cette terreur, assourdie parce que jamais explicite, et pour cela même impossible à calmer, il me semble qu’elle ne m’a jamais quitté depuis. J’ai pensé pouvoir l’approcher il y a quelques années dans un essai-récit intitulé précisément De quoi j’ai peur ; mais je voudrais à présent remonter plus haut et creuser plus profond en moi-même, si cela est possible.
Des moments mêmes de l’Occupation j’ai du mal à parler directement : quand il m’est arrivé d’essayer de le faire, dans des textes brefs, j’ai eu l’impression d’écrire de petits morceaux de fiction qui cherchaient à capter comme à la dérobée des aspects disloqués, et de leur donner artificiellement un contexte (à propos du passage de la ligne de démarcation, d’un séjour chez des paysans, des bombardements de Saint-Étienne, d’une retraite aux flambeaux l’été 1944 dans un petit village de la Haute-Loire). Je peux dire en revanche qu’une fois la guerre et les bouleversements qui s’ensuivirent vraiment terminés, je commençai — me détendant un peu — à éprouver après coup l’effondrement qui m’avait atteint pendant ces années-là : un effondrement qui avait eu lieu à l’extérieur de moi, à l’extérieur du petit cercle familial solidaire et menacé où je m’étais senti protégé. Effondrement de quoi au juste ?
Pour m’en tenir au plus factuel, lorsque notre situation se stabilisa un peu, au sortir de la guerre, je ne savais pas vraiment comment je m’appelais, quel était mon nom de famille, car nous en avions changé, et je devais apprendre le nouveau — le vrai — comme s’il avait été inventé à l’instant. Je ne connaissais pas mon adresse ; à un moment où je devais apprendre à faire coïncider ce que je savais de moi et ce que le monde extérieur (l’école) en savait, j’apprenais au contraire que le lien entre les deux avait été menacé et même rompu pendant un certain temps. C’était comme si ce lien, au lieu d’être pris en charge par l’état des choses, de la stabilité sociale, s’était trouvé m’incomber. Je crois avoir passé beaucoup de temps, dans les années qui ont suivi, à réparer silencieusement ce lien, et surtout à assurer de façon quasi fanatique, excessive, la continuité du lien entre moi et moi : le lien par lequel je m’assurais de ce que j’étais — en ne cessant de renouer le lien avec ma propre pensée, le lien entre mes pensées, non pas pour les rendre cohérentes, logiquement compatibles entre elles, mais pour les souder les unes aux autres, pour qu’elles entrent silencieusement en communication les unes avec les autres. Je m’enseignais ainsi une façon de penser— dépourvue de méthode — acharnée à maintenir un lien interne, un lien de conscience ou de solidarité intime assez solide pour traverser le danger des ruptures temporelles et des séparations, le passage du jour à la nuit (et retour) aussi bien que celui de la paix à la guerre ou du calme au trouble. Relisant mes essais, en particulier celui qui figure ici en tête (« À quoi comparer la conscience ? »), j’y vois à présent l’effet quasi pathologique de cette inquiétude continuée, sans pour autant pouvoir ni me déjuger, ni coïncider exactement avec ce que j’ai essayé de dire là, et que je livre pour pouvoir le regarder à neuf, le lire comme par-dessus l’épaule du lecteur. Car cette conscience hypertrophiée, qui cherche à déborder de la zone de clarté vigile à laquelle elle est assignée et qui ne se reconnaît pas de bords, je crois qu’elle correspond bien à l’une des virtualités de la conscience de tous : elle montre ce qui arrive à la conscience lorsque ce qui assure la paix du monde et la protection de l’individu est détruit ou mis gravement en cause.
€ 20.00