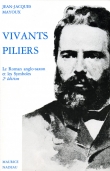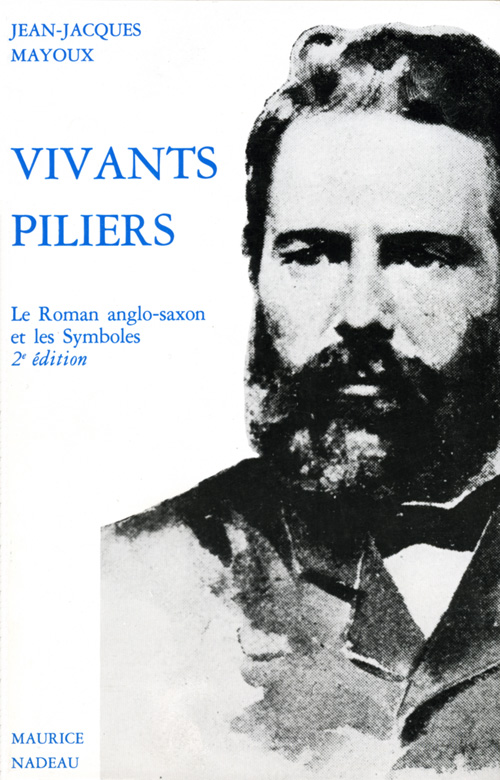Vivants piliers
Le roman anglo-saxon et les symboles. De Quincey, Melville, Hawthorne, Conrad, Henry James, Virginia Woolf, Joyce, Beckett... Jean-Jacques Mayoux les fait découvrir à ceux mêmes qui croient bien les connaître, dans un ouvrage publié la première fois en 1960, devenu introuvable, et que nous rééditons sur la demande instante de professeurs, d’étudiants, d’amateurs de la littérature anglo-saxonne. Pour tous, Vivants piliers est non seulement un modèle de critique érudite et profonde, mais un classique du genre. 328 p. (1985) 19 euros
Jean-Jacques Mayoux (1901-1987) a été critique littéraire et professeur de littérature anglaise réputé, à la Sorbonne de 1951 à 1973. Résistant (CDLR), il a signé le manifeste, dit des 121, de la Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d'Algérie en 1960. ll est mort le
Extrait
Pour Marie-Louise
DIDEROT ET COLERIDGE
J’ai longtemps vu, c’est l’une des images de ma jeunesse, Diderot se dresser au seuil du monde moderne comme un puissant annonciateur. Mais il a ses limites. Ce sont celles de la vision rationnelle ou, plutôt, celles du monde de l’expérience interprété par la raison, mais d’ailleurs solide et concret; solide et concret mais d’ailleurs humanisé, mais connaissable, assimilé aux catégories de la conscience. De là vient que Diderot, si neuf, est malgré sa hardiesse si daté. Aujourd’hui rien ne me frappe autant dans son esthétique, au milieu de ses intuitions éblouissantes, que sa distinction obstinée des genres et notamment du roman et de la poésie.
La poésie, il la conçoit emblématique, hiéroglyphique, représentant ce qu’elle dit par la modulation plastique de la phrase et sa vertu subjective :
Il passe dans le discours du poète un esprit qui en meut et vivifie toutes les syllabes... c’est lui qui fait que les choses sont dites et représentées à la fois... et que le discours n’est plus seulement un enchaînement de termes énergétiques qui exposent la pensée avec force et noblesse, mais que c’est encore un tissu d’hiéroglyphes entassés les uns sur les autres qui la peignent. Je pourrais dire en ce sens que toute poésie est emblématique.
Que les exemples d’hiéroglyphes ou emblèmes poétiques quand ils sont modernes et ne proviennent pas d’Homère, de Virgile ou de Lucrèce, soient tirés de Boileau ou de Voltaire, cela déconcerte; et qu’ils soient curieusement marqués par l’imitation et par la reconstitution dans l’imagination d’une réalité matérielle: « demisere est aussi mou que la tige d’une fleur, gravantur pèse autant que son calice chargé de pluie... ».
D’autre part, il est vrai, Diderot met en liberté l’imagination poétique, portée par le verbe hors des limites de la réalité perçue, au-delà de l’expérience, de sorte « qu’elle passe rapidement d’image en image; si elle discerne des plans, elle ne les gradue ni ne les établit; elle s’enfoncera tout à coup à des distances immenses... ».
Mais les distances immenses veulent seulement dire que la prison est très grande, non pas que tout à coup par un effort extrême on aura franchi les limites. L’être, finalement, dans cette esthétique, n’est jamais en cause : elle ne touche pas à la métaphysique. Tout a un lieu suffisant dans la tête humaine. Il sera beaucoup question dans ces essais d’univers intériorisé; il faut pour cela qu’il soit senti comme redoutablement étranger : il n’y a correspondance qui vaille que là où le macrocosme subsiste terriblement en face du microcosme. Il n’est ici, dans notre XVIIIe siècle, chez Sterne ou chez Diderot, question que d’un univers subjectif, humanisé, soumis à nos lois, régi par nos catégories, intérieurement compartimenté : il est tout naturel, dans un monde ainsi conçu, qu’une vision poétique soit distinguée sévèrement de la vision romanesque; et, plus précisément, opposée à elle.
Il est vrai que dans le sens de la création poétique l’effort de Diderot va loin. L’image poétique du réel jaillit en liberté — de la liberté, de la déficience, de l’absence. La stimulation positive de cette force plasmatrice par quelques données n’est pas plus importante que l’effacement des résistances. Tout ici sera donc ellipse et discontinuité, de sorte que l’esprit puisse jouer dans les intervalles — les vides où justement parce qu’il n’y a rien se logera l’illusion.
Le vrai goût s’attache à un ou deux caractères et abandonne le reste à l’imagination. Les détails sont petits, ingénieux et puérils. C’est lorsqu’Armide s’avance noblement au milieu de l’armée de Godefroy, et que les généraux commencent à se regarder avec des yeux jaloux, qu’Armide est belle... Si une figure marche, peignez-moi son port et sa légèreté, et je me charge du reste. Si elle est penchée, parlez-moi de ses bras seulement et de ses épaules... Si vous faites quelque chose de plus, vous confondez les genres : vous cessez d’être poète, vous devenez peintre ou sculpteur...
Mais si l’univers du poète est dans cette vue un déroulement subjectif et relativement libre, l’univers du romancier est à l’inverse et l’illusion y est produite de tout autre manière. Le poète me place au cœur de moi-même et me met en mesure de créer un monde autour. Le romancier me tire hors de moi-même et m’installe dans un monde qui semble être déjà là et m’attendre. Une sorte d’abondance gratuite, gaspillée en apparence et en fait habilement distribuée, est ici ce qui me donnera le change. Diderot qui comme tout son temps méconnaît Defoe l’attribue à Richardson : « Sachez que c’est à cette multitude de petites choses que tient l’illusion. »
Comment s’y prendra donc ce conteur-ci pour vous tromper ?... Il parsèmera son récit de petites circonstances si liées à la chose, de traits si simples, si naturels, et toutefois si difficiles à imaginer, que vous serez forcé de vous dire en vous-même : « Ma foi, cela est vrai, on n’invente pas ces choses-là... »
« Vous tromper. » Stendhal continuera à agiter dans Racine et Shakespeare le problème de l’illusion parfaite. Mais il sait déjà que le sage Johnson n’y croit pas. Coleridge emploiera sous ce rapport une expression subtilement nuancée : il s’agira d’obtenir a willing suspension of disbelief, un consentement à suspendre son refus de croire. Il y a bien en tout cas dans la création de cette illusion qu’est le monde romanesque de Diderot, un mode d’invention distinct enjeu, dont Defoe du Journal de l’Année de la Peste est sans doute le créateur, et dont le John Hersey d’Hiroshima ou de la Muraille serait l’héritier légitime. Mais depuis De Quincey, depuis Hawthorne, depuis Flaubert ou Nerval, tout l’effort du roman ou du conte a été d’ignorer les limites qui étaient censées le séparer de la création poétique, qui lui interdiraient le jeu des symboles. Le monde où nous vivons n’est plus celui de M.Jourdain où tout ce qui est prose n’est pas vers. La reconquête de la prose par le génie poétique a été liée, je crois, à un certain démiurgisme romantique dont les Anglo-Saxons me paraissent offrir le type. Je le trouve d’abord chez Coleridge, que je suis ainsi tenté de mettre en face de Diderot pour nous éclaircir les idées, ce qui sans doute n’est pas un usage courant à faire de Coleridge.
Je ne connais pas de génie plus humainement attachant, ni plus passionnant à suivre dans sa démarche intellectuelle, que Samuel Taylor Coleridge. Une sorte d’innocence, une candeur enfantine, une absurdité touchant au grotesque le marquent d’épisode en épisode, qu’on le voie s’engager dans un régiment de dragons parce qu’il a fait des dettes à l’Université et qu’il est accablé par le sens de sa culpabilité, ou bien que, n’ayant pas réussi à fonder avec Southey la colonie socialiste de Pantisocratie, se trouvant de surcroît rejeté par Mary Ann Evans, quam perdite amabam, il se laisse marier à la sœur de la femme de Southey pour qui il éprouvera après quelques flottements une douloureuse et justifiable aversion. Ou qu’enfant déjà il se soit enfui de la maison familiale après une querelle avec son frère, qu’il croyait avoir tué peut-être, ou bien ce sera cette folle affinité élective qu’il se trouvera, une fois marié, pour Sara Hutchinson, la belle-sœur de Woodsworth et qui fleurira en cette liaison bizarre, cruellement et voluptueusement chaste, déroulée des années durant de lectures poétiques en promenades sentimentales. Perplexe, étonné de se trouver dans son corps, il mena dans l’absence de lui-même une existence incohérente, bourrelée de remords, hantée de terreurs, tourmentée d’impossibles amours et de projets jamais réalisés.
Sainte-Beuve voulait qu’on prît tout homme de génie à son commencement. Si on le fait pour Coleridge, on le verra à vingt ans tel qu’il sera toujours et qu’on prétendra que l’opium l’a fait, déchiré, paralysé, témoin cruellement lucide de son abjection et de son impuissance. Au commencement est l’angoisse ; « J’ai fui dans les débauches l’angoisse silencieuse et solitaire... » Les militaires, pour lui rendre la liberté, décideront qu’il est fou. Le fait est qu’il dépasse follement chaque circonstance, qu’il outre follement chaque sentiment.
Mais ce névrosé, de façon organique et sans doute liée à cette névrose, est l’un des grands inventeurs du romantisme, de ce que j’appellerai, s’agissant d’une maladie que nous portons dans nos veines, du romantisme généralisé, qui ne connaît plus ni vers, ni prose, ni genres. Au seuil d’une enquête sur cette invention et ses effets il est bon, je crois, de retrouver l’homme et son histoire, l’homme et d’abord l’enfant aux colères soudaines, aux amertumes intolérables, que réduit au désespoir l’entente de sa nourrice et de son frère, et qui se jette sur celui-ci un soir avec une fureur homicide, et qui s’enfuit comme le Caïn maudit — et manqué — qu’il se sent, qui ramène peut-être ses premières névralgies de la nuit froide qu’il passe au bord de la rivière, qui ramènera sûrement de là son premier sentiment, son premier accablement de culpabilité.
« Qu’il est laid ! » s'écriera James Boyer, son maître en la bonne mais lugubre école de Christ’s Hospital. Les femmes, sans doute, quand il aura l’âge de les aimer, penseront comme James Boyer devant ce visage aux traits bouffis, déformé par les végétations (« je ne peux pas respirer par le nez — aussi ma bouche aux lèvres épaisses et sensuelles, est-elle presque toujours ouverte »). Elles ne l’aimeront guère. Il en sera au désespoir.
Cette exclusion réelle ou imaginée dès l’enfance, cette première séparation, la solitude trop réelle et trop radicale des années d’école se joignent plus qu’elles ne s’opposent au ravissement dans lequel il vit réfugié, et que tout nourrit. Son père lui explique une nuit le mouvement des astres, et là où un autre aurait vu quelques faits enseignés, il voit, lui, un conte merveilleux, qui se joint dans son imagination extasiée aux Mille et Une Nuits comme à Robinson Crusoé.
Tout cela pour lui est magie et se trouve mis à pareil usage : lui donner le sentiment d’un univers vivant tenu ensemble par de mystérieuses intentions, manifestant une puissance cachée: cosmos un et indivisible, comme il dit, opposé à la multiplicité d’agencements rationnels, à l’enchevêtrement inerte de chaînes causales, que lui paraissait proposer la pensée du XVIIIe siècle.
Quand il se connaîtra, Coleridge se verra tel, aussi étranger que ce tempérament et cette enfance devaient le faire. Sa quête de l’être tient à sa destruction des apparences, à un mode d’appréhension qui leur confère un caractère de masque : « Dès l’enfance, j’ai pris l’habitude d’abstraire et pour ainsi dire de déréaliser (unrealise) tout ce à quoi mon regard prenait un intérêt particulier; puis, par une sorte de transfusion et de transmission de ma conscience, je m’identifiais à l’objet » (Anima Poetæ). Processus complexe, au moins double, qui affecte et le monde extérieur et l’intérieur. Car d’une part et tout d’abord l’objet est « déréalisé », enlevé au monde, soulevé hors du contexte matériel et logique où il se trouvait encastré et situé, pourvu déjà d’un statut spirituel, mais, d’autre part, c’est pour que l’homme tout entier à son tour s’y absorbe, s’y perde, s’y abolisse.
De cette absence au moi, de cette absence au monde, de ce don et de cette concentration de conscience se créera quelque chose comme un état mystique, une extase dont les Carnets donnent parfois des exemples saisissants; en novembre 1795 c’est : « Fantôme d’une montagne — les formes s’emparant de mon corps au passage et devenant réalité - moi, un fantôme, jusqu’à ce que j’eusse reconquis ma substance. »
Quand l’opium — le laudanum — qu’il fallait pour engourdir les névralgies et, plus profondément, apaiser l’angoisse, vint-il s'ajouter à tout ce qui le poussait hors du réel ? A coup sûr, de très bonne heure. Un tempérament anxieux, des sensations trop intenses et des nerfs à vif durent le vouer aux formes les plus aiguës de la douleur. Dès mars 1798, quelques mois avant la rêverie de Kubla Klan, Coleridge note la frénésie de douleur que lui a causée une dent gâtée. Puis : « Le laudanum m’a donné la paix — paix combien divine, dans quelle oasis enchantée, de fontaines, de fleurs et d’arbres, au beau milieu d’un désert de sable. » Le laudanum a donc déjà cessé d’être un médicament : c’est la clé d’un monde.
C’est ainsi que Coleridge prit l’habitude, qu’il a beaucoup analysée, de ne plus chercher à s’inscrire dans la réalité matérielle, parce qu’elle le blessait toujours quelque peu, parce qu’il trouvait en lui-même, dans le jeu de ses idées, un accomplissement riche et intense. C’est ainsi qu’il se mit à vivre dans ce qu’il a nommé l’intermundium de l’imagination, un intermundium qui l’enlève hors du temps (« dans lequel le présent est encore constitué par l’avenir ou le passé ») — qui le place en fait dans le milieu temporellement indéterminé de la qualité pure.
En outre, les philosophes platoniciens, avec leur contingent de mystères et de merveilles, les Plotin, Iamblichus, Gemisthus Pletho, n’ont sans doute jamais eu déplus jeune lecteur. Cependant, bien qu’ils soient alors de sa part l’objet d’une dilection singulière, c’est Hartley qui l’envoûte, ce bizarre penseur matérialiste-chrétien qui, après les animaux-machines de Descartes, conçoit l’homme-machine, spectateur en lui-même d’enchaînements mécaniques qu’il prend pour pensée et pour liberté. Coleridge va plus loin encore, ou dit, plus clairement, que la pensée est corporelle, qu’elle est mouvement. Ainsi préserve-t-il l’essentiel : l’unité du monde. Que tout y soit esprit ou que tout y soit matière, cela n'importe pas tant au poète, hanté depuis toujours par une vision, et par un besoin d’unité totale; un tel « matérialisme » moniste nourrit beaucoup plus l’imagination que le dualisme qui confinait l’esprit et qui rejetait la matière dans l’inertie et dans la mort.
Le premier enfant de Coleridge fut baptisé Hartley, le second Berkeley. Le passage de l’un à l’autre nous éclaire aussi bien comme évolution que comme constante. « Nos poètes », écrit-il en décembre 1796, « entendent par âme un être qui habite notre corps et qui le fait mouvoir, je ne suis pas d’accord, non que je sois matérialiste, mais parce que je suis berkeleyen. » L’important, c’est qu’en tout cas il n’est pas d’accord, que, matérialiste ou berkeleyen, il soit moniste.
Le système hartleyen a un autre aspect : c’est un associationnisme. Or si Coleridge devait réagir avec véhémence contre l’inertie spirituelle qu’implique un enchaînement automatique d’associations, le phénomène, à distinguer du système, le fascine. On le voit maintes fois noter le déclenchement en lui-même d’un souvenir par une sensation nouvelle retrouvant la trace d’une ancienne, et faisant lever à l’instant un cortège de choses oubliées.
A travers des provocations successives, une âme en peine s’interroge. « Je commençais à me demander », dit-il dans Biographia Literaria, « quelle preuve j’avais de l’existence extérieure de quoi que ce fût. » Entre Berkeley et cet homme si peu au monde, si arrêté à ses sensations par leur intensité même, les affinités étaient profondes. Sans cesse le présent se dérobe sous lui : il lui apparaît « comme un rêve intense, ou la répétition exacte de quelque circonstance passée »; il est paramnésique de nature. Lorsque naît l’enfant Hartley, la circonstance est de celles qui lui inspirent ce sentiment d’irréalité. Quand en Allemagne, en 1798, il apprend la mort de son fils Berkeley, il a des formules symétriques : « la mort donne un tel vertige d’insécurité et désubstantialise si bien les choses vivantes qu’on a saisies et tenues ! » Dans une lettre à son ami Thelwall il écrit : « Je me suis à peu près fait à l’idée que j’étais une simple apparition... »